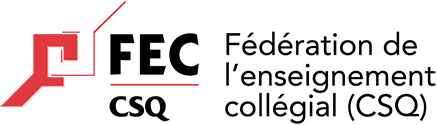Édith Pouliot, vice-présidente FEC-CSQ.
En août dernier, la ministre Pascale Déry a, sur les ondes de Radio-Canada, ouvert la porte à l’élargissement de la loi sur la liberté académique au réseau collégial[1]. Alors que l’année dernière, la Fédération de l’enseignement collégial (FEC-CSQ) a mené une campagne à cet effet[2], l’arrivée d’une nouvelle vis-à-vis à l’enseignement supérieur, Martine Biron, nous incite à rappeler les raisons qui nous ont conduits à revendiquer l’élargissement de la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire (loi 32).
Du rapport Cloutier de 2021 au rapport d’experts de 2025 : une multiplication des appuis et des arguments
Intégrer les cégeps à la loi qui encadre le milieu universitaire viendrait d’abord corriger une erreur de conception de la loi qui ne reconnaissait pas le statut d’enseignement supérieur au réseau collégial tel qu’énoncé dans la Recommandation de l’UNESCO sur la liberté académique. Le rapport Cloutier (Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire) soulignait d’ailleurs dès 2021 que, bien que leur mandat ait été restreint au milieu universitaire, les cégeps font partie de l’enseignement supérieur, soulevant ainsi des questions analogues. « Plusieurs des principes abordés et définis par la Commission dans le cadre de ses travaux pourraient donc aussi s’appliquer aux cégeps, à commencer par la liberté d’enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte[3] ». Le mémoire du Conseil supérieur de l’éducation sur la liberté académique, publié en 2021, allait dans le même sens.[4]
Plus récemment, en juin 2025, le rapport issu de l’Enquête administrative sur la gestion des situations impliquant des comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants traitant de situations survenues dans les collèges Dawson et Vanier, énonce quatre recommandations générales, la première étant d’ « adopter une loi pour encadrer la liberté académique dans le réseau de l’enseignement collégial[5] ». Le rapport d’enquête souligne que « cette protection n’est pas suffisante pour assurer l’autonomie professionnelle du corps professoral » et que la liberté académique est « à géométrie variable » dans les collèges.
De la nécessité de l’encadrement légal
Bien que la convention collective des enseignantes et enseignants de cégep contienne une annexe sur la liberté académique depuis quelques années, c’est un élargissement de la loi actuelle aux collèges qui est nécessaire, et ce, bien entendu, sans en modifier la portée, afin que l’ensemble des réseaux d’enseignement supérieur jouisse des mêmes protections, en toute cohérence. Rappelons plus précisément pourquoi.
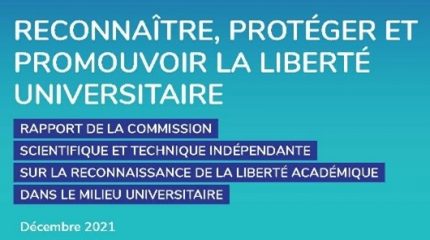 La loi 32 qui encadre les universités sur ce sujet, en plus d’uniformiser les pratiques et les protections, oblige les établissements à adopter une politique sur la liberté académique. Cette dernière permet alors une meilleure gestion des plaintes, mais également davantage de formation et de sensibilisation. En d’autres termes, l’objectif est de prévenir des situations de crise, comme celle que l’Université d’Ottawa a pu vivre avec l’affaire Lieutenant Duval.
La loi 32 qui encadre les universités sur ce sujet, en plus d’uniformiser les pratiques et les protections, oblige les établissements à adopter une politique sur la liberté académique. Cette dernière permet alors une meilleure gestion des plaintes, mais également davantage de formation et de sensibilisation. En d’autres termes, l’objectif est de prévenir des situations de crise, comme celle que l’Université d’Ottawa a pu vivre avec l’affaire Lieutenant Duval.
Actuellement dans nos cégeps, aucun processus de gestion des plaintes n’est prescrit. Or, dans un sondage mené par la FEC-CSQ auprès de ses membres en 2024, 59% des répondantes et répondants considéraient que les litiges relatifs à la liberté académique devraient être traités au sein de leur établissement, évitant ainsi une certaine judiciarisation des situations. En l’absence de processus uniforme dans le réseau, cela a mené à des modes de gestions à géométrie variable au sein des établissements et à des tensions entre le corps enseignant et leur direction. Rappelons également que le questionnaire utilisé par la FEC-CSQ était identique à celui élaboré par les membres de la commission Cloutier et que les résultats obtenus étaient similaires sur l’ensemble des sujets sondés, notamment sur la connaissance sur la liberté académique ou les expériences avec la censure.[6]
En plus de la gestion des plaintes et dans une optique de collégialité propre à l’enseignement supérieur, nous pensons que les comités sur la liberté académique qui seraient institués dans les cégeps du Québec joueraient un rôle constructif en permettant de mettre en place des mesures de sensibilisation et d’information, tel que prévu dans la loi encadrant la liberté académique dans le milieu universitaire (article 4.4). Ces comités pourraient donc agir en amont des plaintes, en offrant par exemple un service-conseil pour prévenir de potentiels dérapages.
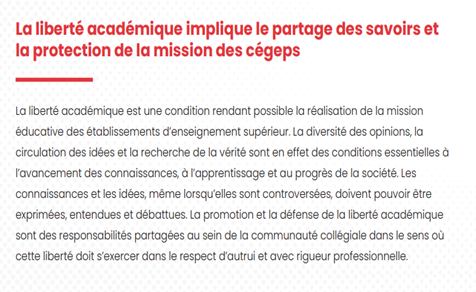 Extrait de L’énoncé de principe sur la liberté académique au collégial adopté par les membres de la FEC-CSQ
Extrait de L’énoncé de principe sur la liberté académique au collégial adopté par les membres de la FEC-CSQ
Enfin, la possibilité d’exprimer son opinion sur la société et sur une institution, y compris l’établissement duquel la personne relève (article 3.1) est également primordiale afin que les professeures et professeurs, titulaires de la liberté académique, se sentent protégés, cessent de s’autocensurer, et puissent contribuer pleinement à la mission de former des citoyennes et citoyens éclairés qui auront eu le privilège de participer à des débats d’idées au cours de leur parcours collégial. Tel que nous le mentionnons dans l’énoncé de principe sur la liberté académique au collégial : « La diversité des opinions, la circulation des idées et la recherche de la vérité sont en effet des conditions essentielles à l’avancement des connaissances, à l’apprentissage et au progrès de la société. Les connaissances et les idées, même lorsqu’elles sont controversées, doivent pouvoir être exprimées, entendues et débattues ». Cette affirmation est d’autant plus vraie dans l’ère trumpiste de post-vérité et de clivage actuel.
Madame la ministre, afin de corriger, le plus rapidement possible cette disparité entre les paliers de l’enseignement supérieur, nous vous invitons donc à donner suite à la revendication visant à élargir au réseau collégial la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire. Alors que les appuis à cette proposition se multiplient, n’attendons pas la prochaine crise pour mettre en place des outils permettant à toute la communauté collégiale de faire vivre l’apprentissage et le savoir dans un espace serein, propice à la réussite de la population étudiante.
Télécharger l'affiche : Pour la pleine reconnaissance de la liberté académique au collégial
[1] Tout un matin, « Je ne reculerai pas », affirme la ministre Déry au sujet des compressions au collégial, Radio-Canada, août 2025, (à partir de 7 minutes 50 secondes).
[2]FEC-CSQ, Pour une meilleure reconnaissance de la liberté académique au collégial, novembre 2024.
[3] Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, Reconnaître, protéger et promouvoir la liberté universitaire, décembre 2021, p.61.
[4] Conseil supérieur de l’éducation, Mémoire sur la liberté académique en enseignement supérieur, juin 2021.
[5] Ministère de l’enseignement supérieur, Enquête administrative sur la gestion des situations impliquant des comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la santé physique ou psychologique des étudiants, juin 2025, p. 49.
[6]FEC-CSQ, Liberté académique : la FEC-CSQ demande l'extension des dispositions législatives aux cégeps - Fédération de l’enseignement collégial (FEC-CSQ), juin 2024.