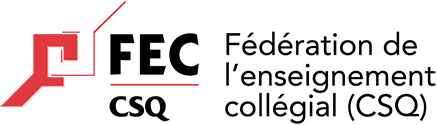En lutte. Encore.
La lutte est loin d’être terminée et elle n’est surtout pas linéaire. Les gains et les acquis des dernières décennies, bien que réels, semblent fragiles face aux reculs constants. Les attaques contre les droits des femmes et des minorités se multiplient à un rythme effarant : recul du droit à l’avortement, discours masculinistes décomplexés, montée en puissance de gouvernements de droite.
Par Julie Allard, coordonnatrice du Comité d’action féministe de la FEC (CAFFEC)
Cette lutte féministe toujours actuelle se déploie dans un contexte social de grande fatigue et de perte de repères. L’épuisement rend l’engagement collectif plus ardu. Le livre Brûlées des sœurs Nagoski explore le burn-out dans un contexte social patriarcal et souligne comment les règles du jeu dans cette société sont au désavantage des femmes. Les militantes qui jonglent entre luttes sociales et exigences du quotidien font également face à une absence de reconnaissance, à la lenteur des changements et au manque d’alliés, comme en témoigne Marylise Hamelin dans son dernier ouvrage, Solitudes.
Alors, où sont les alliés? Comment leur faire comprendre leur importance et les impliquer davantage?
Quels sont les obstacles à l’engagement dans la lutte?
Les raisons de la passivité ou du désintérêt peuvent être multiples. En raison des préjugés sexistes et de la croyance de « l’égalité déjà-là », la lutte féministe est souvent minimisée, voire méprisée. Que l’on soit militante ou allié, c’est aussi une étiquette qui peut être difficile à porter. L’accumulation des crises sociales et des injustices médiatisées peut provoquer également un engourdissement émotionnel, couplé d’un sentiment d’impuissance. Ce flux incessant d’actualités et l’accélération technologique créent un sentiment de saturation. Enfin, la conviction que chacun·e est responsable de son sort et que l’environnement social a peu d’impacts reste bien ancrée dans les mentalités. Quoi faire alors? Se replier? Non. Résister!
Pourquoi lutter, résister, agir?
Résister, c’est créer des liens, briser l’isolement et transformer l’indignation en force collective. Ce n’est pas seulement une obligation morale, mais aussi un moyen de retrouver du pouvoir sur nos vies et d’inspirer le changement. L’action collective génère de l’énergie, de la solidarité et donne un sens profond à nos combats.
Résister, c’est aussi prendre soin : dans un monde en crise, il est crucial de développer des qualités sociales adaptées.
✊ Solidarité : Ne pas laisser les autres porter seuls le poids des luttes. Pour bell hooks, « la véritable solidarité politique, c’est apprendre à lutter contre des oppressions qu’on ne subit pas soi-même. Pour elle, il s’agit de construire de véritables alliances entre les unes et les autres. »
✊ Résilience : Trouver des stratégies pour continuer sans s’épuiser.
✊ Entraide : Prendre soin des autres, offrir du soutien, créer des espaces de dialogue bienveillants.
Comment s’engager dans la lutte plus sereinement?
Réflexions personnelles pour personnes militantes ou alliées : accepter de déranger (ceci pour les personnes militantes)
👉 « Se montrer obstinée, c’est volontairement faire état de son désaccord, c’est se positionner en fonction d’un désaccord. Et rendre public ce désaccord amène parfois à se montrer désagréable ». En effet, on peut se demander, dans le fond, "qui profite d'un féminisme joyeux et poli?". Comme l’explique bien Sara Ahmed, il faut parfois accepter de « devenir une féministe rabat-joie ». Cette réflexion fait écho à celle portée précédemment par des autrices québécoises dans leur ouvrage Libérer la colère, où la question de la colère des femmes, taboue et honnie, a été traitée en profondeur.
👉 Faire preuve aussi d’indulgence et de tolérance, en particulier envers les personnes qui souhaitent être des alliées, mais qui ne possèdent peut-être pas encore tout le vocabulaire et la compréhension nécessaires.
👉 Remettre en question la glorification du travail acharné et l’injonction à la productivité constante, même dans la militance. Accepter d’être une « mauvaise » féministe.
Accepter d’être dérangé.e et inconfortable (ceci pour les personnes alliées)
👉 Pratiquer l’introspection : se remettre en question pour mieux avancer. S’interroger sur nos propres réactions émotionnelles et intellectuelles face aux revendications de certains groupes (au lieu de se dire : « pas encore! »).
👉 Cultiver la patience et l’indulgence : le changement demande du temps et de l’adaptation. La lutte sociale se fait souvent en même temps que se précisent les nouveaux concepts théoriques qui permettent de mieux appréhender des problématiques. Cela fait en sorte que les personnes militantes ne sont pas parfaites et infaillibles.
👉 Accepter de se tromper, d’apprendre et d’évoluer : reconnaître ses erreurs permet de renforcer ses convictions et son engagement.
Ne pas négliger les petites actions
👉 Soutenir les causes féministes au quotidien : un simple « like », une pétition signée, un don, le plus petit soit-il, à une organisation féministe, modifier son fonds d’écran pour appuyer un événement, proposer de l'aide à des amies féministes, demander si on peut faire quelque chose peuvent contribuer au mouvement.
👉 S’éduquer sans s’épuiser : suivre des personnalités engagées sur les réseaux sociaux pour s’informer sans surcharge mentale et manipuler ses algorithmes.
👉 Prendre la parole : en particulier pour donner son appui à une proposition féministe. Le silence ne peut pas systématiquement être interprété comme un soutien passif. Il peut démontrer un désaccord qui n'attend que le déplacement de la fenêtre d'Overton pour s'exprimer.
👉 Distinguer critique et récupération politique : certains termes comme « woke » et « intersectionnalité » sont détournés pour discréditer certaines luttes. Il est essentiel de se réapproprier ces concepts et de ne pas tomber dans les pièges rhétoriques.
Et cette lutte, il faut la faire contre qui et contre quoi?
Ou plutôt : pour quoi et avec qui?
La Marche mondiale des femmes 2025, qui aura lieu le 18 octobre 2025 et qui est lancée en ce 8 mars 2025, identifie trois axes principaux de lutte pour les femmes à travers le monde : les violences, les inégalités économiques et la justice climatique.
|
Violences envers les femmes Les revendications féministes face aux violences sont nombreuses et diffèrent selon la région du monde. Plus près de nous, la CSQ, avec des partenaires de l’Intersyndicale des femmes, a récemment réclamé au gouvernement québécois l’ajout de 10 jours d’absence rémunérés dans les normes du travail pour les victimes de violence conjugale. Depuis 2021, une nouvelle disposition a été introduite à la loi sur la santé et sécurité au travail pour responsabiliser les employeurs face à la violence conjugale vécue par des personnes qui sont à leur emploi, une avancée qui doit être suivie de près. |
|
Inégalités économiques Aussi étonnant que cela puisse sembler, près de 30 ans après l’adoption de la loi censée la garantir, l’équité salariale reste inaccessible pour de nombreuses femmes. La toujours difficile conciliation famille-travail continue également de peser sur les femmes, aggravée par le manque de places en garderie et l’absence de politiques adaptées. Ces réalités nécessitent des solutions structurelles et une reconnaissance accrue des besoins spécifiques des travailleuses. Enfin, des enjeux de santé féminine, tels que les symptômes handicapants générés par les menstruations et la ménopause, sont encore largement ignorés, bien qu’ils aient un impact important sur le rendement des travailleuses. Nombre d’entre elles travailleront moins d’heures ou prendront leur retraite de façon prématurée, décisions qui entraînent des répercussions économiques importantes. |
|
Justice climatique Les effets des changements climatiques ne sont pas ressentis de manière égale : les femmes, notamment celles des communautés vulnérables, en subissent de plein fouet les conséquences. Les dérèglements environnementaux amplifient les inégalités sociales existantes : « l’ONU a déclaré que les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir que les hommes lorsqu’il y a une catastrophe climatique ». Ainsi, l’approche écologique et la justice climatique ne peuvent être dissociées des questions de genre. |
Face à ces défis, on doit s’appuyer sur la force du collectif : unir ses forces avec d’autres rend la lutte plus efficace et moins épuisante. Parce que lutter ne signifie pas se consumer, mais transformer l’indignation en un moteur de changement durable.
Rendez-vous à la marche mondiale des femmes le 18 octobre 2025!
https://www.cqmmf.org/
Pour plus d'informations sur le 8 mars >> Journée internationale des droits des femmes – Centrale des syndicats du Québec (CSQ)